Film de John Huston
Titre original : The Kremlin Letter
Année de sortie : 1970
Pays : États-Unis
Scénario : John Huston et Gladys Hill, d’après le roman de Noel Behn The Kremlin Letter
Photographie : Edward Scaife
Montage : Russell Lloyd
Avec : Bibi Andersson, Richard Boone, Nigel Green, Dean Jagger, Patrick O’Neal, George Sanders, Max von Sydow, Orson Welles, Barbara Parkins, Niall MacGinnis
John Huston, à propos de « La Lettre du Kremlin » : […] tous les espions y sont des gens affreux, comme dans la réalité, j’en suis sûr.
Extrait d’une interview donnée à la revue Positif en 1972.
Dans La Lettre du Kremlin, John Huston décrit les rouages tordus et le cynisme total propres aux services secrets et à la politique internationale, univers dont le film est l’une des peintures les plus acides que le cinéma ait faite.
Synopsis de La Lettre du Kremlin
1969, en pleine Guerre Froide. Charles Rone (Patrick O’Neal), brillant officier de l’US Navy, est engagé par les services secrets américains pour mener une mission secrète en Russie.
Sous les ordres de « Highwayman » (Dean Jagger) et d’un dénommé Ward (Richard Boone), Rone est chargé de mobiliser plusieurs espions « freelance ». L’équipe finale se compose de Rone, Ward, du dealer de drogues et souteneur « Janis » (Nigel Green), du dandy homosexuel « The Warlock » (George Sanders), et de « B.A. » (Barbara Perkins), fille de l’expert en vol et cambriolage « The Erector Set » (Niall MacGinnis).
Leur mission : se rendre à Moscou et retrouver une lettre qui évoquerait un arrangement officieux entre les États-Unis et l’Union Soviétique, aux dépends de la Chine. Leurs ennemis directs : le Colonel Yakov Kosnov (Max von Sydow), particulièrement dangereux et sadique, et son supérieur Vladimir Bresnavitch (Orson Welles), membre du Comité Central du Parti Communiste de l’Union Soviétique.
Critique du film
Charles Rone: I think I’m a superior combination of intellect and physique, athlete and scholar. When a risk is to be run I formulate the ideal procedure and calculate the chances involved with exquisite precision. If the percentages are sufficiently in my favor I put myself into motion having absolute confidence in the performance of my reflexes.
Quatre ans avant La Lettre du Kremlin, Richard Burton s’était écrié, vers la fin de L’Espion qui venait du froid (1966) : Que diable pensez-vous que les espions soient ? […] Ils sont juste une bande de minables, de bâtards sordides comme moi : des petits hommes, des ivrognes, des pédés, des maris faiblards, des fonctionnaires jouant aux cowboys et aux indiens pour égayer leurs petites vies pourries.
Cette tirade violente résume assez bien le constat implacable du célèbre film de Martin Ritt, dont l’unique personnage vraiment innocent meurt sous les yeux de l’espion blasé incarné par Burton. La Lettre du Kremlin, s’il est à bien des égards différent de L’Espion qui venait du froid, adopte un point de vue sensiblement identique sur l’univers de l’espionnage.
Basé sur un roman de l’écrivain, scénariste et producteur de théâtre Noel Behn, intitulé The Kremlin Letter et fortement inspiré par l’expérience de son auteur au sein de la Counter Intelligence Corps (service de renseignements américain actif pendant la seconde Guerre Mondiale et aux débuts de la Guerre Froide), le scénario (de John Huston et Gladys Hill, fidèle collaboratrice du réalisateur qui participa également à l’écriture de Reflets dans un œil d’or et L’Homme qui voulut être roi) déroule une intrigue complexe, que l’on suit plutôt bien dans sa globalité mais qui demeure parsemé de zones d’ombre. De l’aveu de Huston lui-même, cela n’avait guère d’importance ; la fameuse lettre qui donne – assez ironiquement – son titre au film se révèle d’ailleurs un enjeu de plus en plus dérisoire au fil des séquences qui le ponctuent, au point que l’on pourrait la considérer comme un MacGuffin.

Charles Rone (Patrick O’Neal) et Janis (Nigel Green), trafiquant de drogues, souteneur et espion free-lance à ses heures…
À travers une galerie d’espions pour le moins pittoresques (un dealer et maquereau ; un dandy ; la fille d’un as du cambriolage ; un tueur sadique ; etc.) et son histoire volontairement tordue et alambiquée, La Lettre du Kremlin se veut avant tout le portrait acide d’un univers violent, cynique et fourbe – celui de l’espionnage et, à travers lui, de la politique internationale à l’heure de la Guerre Froide (quoique le propos du film dépasse clairement ce cadre historique précis). Le plan sur lequel défile le générique de début est d’ailleurs habilement significatif, avec ces fils électriques qui évoquent une toile d’araignée, symbolisant ainsi un piège sournois, autant qu’un univers vicieux et tortueux.
Partageant donc ce regard acerbe, féroce même, sur l’espionnage avec L’Espion qui venait du froid, ainsi qu’une absence totale de parti pris idéologique (dans ces deux films, les services secrets américains et soviétiques rivalisent de cruauté, et dans La Lettre du Kremlin la plupart des espions américains n’agissent que pour l’argent), le film de John Huston adopte toutefois un ton moins sobre et glacial que celui de Ritt, mêlant à la noirceur et la violence du propos des touches de dérision, d’absurdité et d’humour amer.
L’espionnage vu par Huston fait parfois songer à une sorte de « démence organisée » : le monde qu’il dépeint est aussi rigoureux et pointilleux dans son organisation qu’aveugle, fou, déviant, loufoque à certains égards (voir les surnoms donnés à chaque espion : « The Erector Set« , « The Warlock« , « The Highwayman« , etc.) et désespérément vide de repères moraux et idéologiques. Le tout donne l’impression d’une sorte de valse à la fois précise et complètement déréglée, légère et tragique, exécutée par des personnages hauts en couleur qui constituent l’un des points forts du film.
Du héros démesurément sûr de lui (I think I’m a superior combination of intellect and physique, athlete and scholar
) à sa jeune et belle complice surdouée (qui ouvre, dans une séquence étonnante, un coffre-fort avec ses pieds), en passant par tous les autres espions américains et soviétiques – sans oublier l’épouse torturée aux tendances nymphomanes et sadomasochistes de Kosnov -, tous sont à la fois excentriques, crapuleux, manipulateurs, intéressés, souvent cruels, parfois débauchés, mais néanmoins crédibles et nuancés.
Si aucun protagoniste, qu’il soit russe ou américain, n’est juste, honnête et fiable (à l’exception de B.A.), La Lettre du Kremlin évite toute forme de manichéisme en dépeignant des personnages consistants et à plusieurs facettes, à l’image par exemple de l’intriguant, ambigu et charismatique Ward, remarquablement interprété par Richard Boone (il est impitoyable, cynique, corrompu, et il a un certain sens de l’honneur
, dira de ce personnage John Huston). Le premier plan où il apparaît est représentatif du personnage : alors que se déroule l’enterrement d’un espion américain, il affiche un sourire radieux en regardant Charles Rone, qui remplace le mort… On retrouve cette ambiguïté chez le colonel Kosnov (excellent Max Von Sydow), qui est à la fois un assassin sadique, un subordonné écrasé sous la pression de Bresnavitch (Orson Welles) et un mari aussi passionné que leurré (un hen-pecked husband
, s’il fallait l’intégrer dans l’une des catégories listées dans la tirade précitée de Richard Burton dans L’Espion qui venait du froid).
La caractérisation des personnages est donc l’une des raisons qui, avec la solidité de la narration et la mise en scène toujours extrêmement rigoureuse et parfaitement rythmée de John Huston, fait que l’on suit avec beaucoup de plaisir et d’attention La Lettre du Kremlin, le spectateur se résignant progressivement à ne pas tout comprendre à une intrigue au fond secondaire pour mieux mesurer le cynisme propre aux services secrets et à leurs méthodes, notamment lors d’une conclusion en forme d’impasse morale, physique et psychologique pour un « héros » qui en dépit de son sang-froid est lui-même accablé par l’absurdité et la dureté du milieu.
Le plaisir qu’à visiblement pris John Huston à décrire les rouages sordides de la politique internationale, dans ce film boudé par le public à sa sortie, est communicatif ; même si, ne nous y trompons pas, le constat reste noir, et les sourires jaunes.
Le casting
La Lettre du Kremlin réunit un casting prestigieux et international.
Patrick O’Neal incarne à merveille Charles Rone, avec un mélange de désinvolture, de dureté, de froideur mais aussi de sensibilité. Son visage (qui dans certains plans rappellent vaguement celui de James Stewart) et son allure générale correspondent bien à ce personnage affuté, à la fois physique et brillant intellectuellement. Cet acteur qui s’illustra également à la télévision et au théâtre aura quelques années plus tard un rôle secondaire dans Les Femmes de Stepford, un petit joyau du cinéma fantastique, après quoi on ne le retrouvera au cinéma que dix ans plus tard, dans le film d’horreur de Larry Cohen intitulé The Stuff. Woody Allen lui confiera un petit rôle dans Alice en 1990.
Richard Boone excelle dans le rôle du charismatique et insondable Ward, auquel il prête son physique imposant et sa gueule de dur. Connu surtout pour ses rôles dans des westerns, dont trois avec John Wayne, Boone venait de tourner dans L’Arrangement (1969), d’Elia Kazan, avant d’être engagé pour La Lettre du Kremlin.
Dans le rôle de l’imposant Bresnavitch, Orson Welles est parfaitement à l’aise, son charisme, sa voix et sa diction uniques lui donnant naturellement une présence admirable à l’écran. Cet immense réalisateur, qui innova, derrière la caméra, autant au niveau de la technique que de la narration, a joué dans de nombreux films, outre ceux qu’il tourna lui-même ; parmi les plus célèbres, citons Le Troisième homme, le chef d’œuvre de Carol Reed. John Huston l’avait déjà dirigé dans son adaptation de Moby Dick en 1956. La même année que La Lettre du Kremlin, il est à l’affiche de Catch 22, de Mike Nichols (Qui a peur de Virginia Woolf ?), adapté du roman éponyme de Joseph Heller.
Le casting comprend également deux grands comédiens suédois : Bibi Andersson et Max von Sydow. Tous deux ont beaucoup tourné avec le génial Ingmar Bergman ; Andersson tient notamment l’un des deux rôles principaux (aux côtés de Liv Ullmann) du brillant Persona, auquel Lynch fait référence dans un plan de Mulholland Drive ; mais elle joue également (entre autres) dans Les Fraises sauvages et Le Septième Sceau, deux films dont elle partage d’ailleurs l’affiche avec Max von Sydow. Dans La Lettre du Kremlin, elle compose avec beaucoup de justesse une femme à la fois intéressée, perverse, vénale, fragile et sensible – un caractère complexe, donc, à l’image de la plupart des personnages du film.
Max von Sydow, qui fut rendu célèbre pour son rôle culte de chevalier jouant aux échecs avec la Mort dans Le Septième Sceau, figure également dans de nombreux autres Bergman majeurs, dont L’Heure du loup et La Honte. Après La Lettre du Kremlin, il joua dans plusieurs films américains importants, parmi lesquels L’Exorciste de William Friedkin (dans lequel il incarne le fameux prêtre), Les Trois jours du Condor de Sydney Pollack, Conan le Barbare de John Milius et Dune de David Lynch. Woody Allen, qui en tant que grand admirateur de Bergman a dû être profondément marqué par le visage et l’allure uniques de Max von Sydow, lui offrit un beau rôle dans l’un de ses meilleurs films, Hannah et ses sœurs (1986), tandis que Bille August lui confia des rôles de premier plan dans les émouvants Pelle le conquérant (1987) et Les Meilleures intentions (1992), basé sur un scénario de Bergman. Plus récemment on l’a vu (entre autres) dans Minority Report et Shutter Island. Une carrière riche, donc, où l’acteur, toujours actif, côtoya des univers très différents. Comme sa compatriote Bibi Andersson, il campe avec brio dans The Kremlin Letter un personnage ambigu, cruel, à la fois fort et faible, qui ne parvient ni à gérer la pression exercée par son supérieur ni à y voir clair dans un mariage où les sentiments ne sont que de son côté.
Il faut aussi rendre hommage au charme de Barbara Parkins qui illumine l’une des séquences les plus marquantes du film (l’ouverture du coffre-fort), et à Nigel Green et George Sanders (oscarisé pour son rôle dans All About Eve de Joseph L. Mankiewicz), deux acteurs britanniques savoureux dans leur rôle respectif d’espions souteneur et trafiquant pour l’un et dandy travesti pour l’autre.
Truffé de personnages truculents, La Lettre du Kremlin est un film qui ne se berce d'aucune illusion à propos de l'univers du personnage. Le résultat est drôle, acide et, comme toujours avec John Huston, parfaitement maîtrisé.









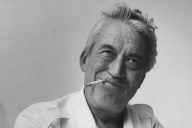





















Aucun commentaire