Film de Philip Kaufman
Année de sortie : 1988
Titre original : The Unbearable Lightness of Being
Pays : États-Unis
Scénario : Jean-Claude Carrière et Philip Kaufman, d’après le roman L’Insoutenable légèreté de l’être de Milan Kundera
Photographie : Sven Nykvist
Montage : Walter Murch
Musique : Mark Adler (musique originale), Leoš Janáček
Avec : Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche, Lena Olin, Derek de Lint
Extrait de L’Insoutenable légèreté de l’être, de Milan Kundera :
Nietzsche nous rappelle que Parménide s’est posé cette question au VIème siècle avant Jésus-Christ. Selon lui, l’univers est divisé en couples de contraires : la lumière-l’obscurité ; l’épais-le fin ; le chaud-le froid ; l’être-le non être. Il considérait qu’un des pôles de la contradiction est positif (le clair, le chaud, le fin, l’être), l’autre négatif. Cette division en pôles positif et négatif peut nous paraître d’une puérile facilité. Sauf dans un cas, dit Nietzsche : qu’est-ce qui est positif, la pesanteur ou la légèreté ? Parménide répondait : le léger est positif, le lourd est négatif. Avait-il ou non raison ? C’est la question. Une seule chose est certaine. La contradiction lourd-léger est la plus mystérieuse et la plus ambiguë de toutes les contradictions.
Bien qu’occultant des aspects essentiels du roman éponyme de Milan Kundera, L’Insoutenable légèreté de l’être réussit par moments à saisir une grâce et une délicatesse qui impriment la mémoire du spectateur.
Synopsis du film
À la fin des années 60, à Prague. Tomas (Daniel Day-Lewis) est un chirurgien volage qui multiplie les conquêtes sans chercher à nouer de relations sérieuses. Sabina (Lena Olin), une artiste peintre, est parmi ses maîtresses celle qui le comprend le mieux, ne cherchant pas davantage que lui à s’engager. Mais lorsque Tomas rencontre Tereza (Juliette Binoche) à l’occasion d’un bref séjour dans une station thermale, il change ses habitudes et accepte qu’elle vienne s’installer chez lui. Il continue cependant de fréquenter d’autres femmes, ce dont Tereza souffre beaucoup.
Le destin de ces trois personnages va être bouleversé par les événements du Printemps de Prague et l’invasion de la capitale par les chars de l’Union Soviétique.
Critique de L’Insoutenable légèreté de l’être
Si l’adaptation d’une œuvre littéraire au cinéma est souvent une entreprise délicate, c’est particulièrement vrai en ce qui concerne certains auteurs et, en l’occurrence, Milan Kundera. Dans les romans de ce célèbre – et brillant – écrivain d’origine tchèque, naturalisé français depuis 1981, les observations que le narrateur (omniscient) livre sur les personnages et leurs comportements occupent une très large place, et il est difficile d’en rendre compte au cinéma sans passer par des procédés tels que la voix off, entre autres. À titre d’exemple, citons François Truffaut qui, dans Les Deux anglaises et le continent (d’après Henri-Pierre Roché), en a fait largement usage.
Ce n’est pas le parti pris que le scénariste français Jean-Claude Carrière et le réalisateur américain Philip Kaufman ont choisi pour adapter L’Insoutenable légèreté de l’être, le quatrième et plus célèbre roman de Kundera, publié en 1984. Ils n’ont pas non plus tenté, par exemple par le biais de flash-back, de décrire le passé du personnage de Tereza, auquel l’écrivain consacre de nombreuses pages. Nous verrons que cela pose plusieurs problèmes ; Kundera, qui est intervenu en tant que consultant pendant la préparation, s’est d’ailleurs montré assez critique, arguant que le résultat avait peu à voir avec l’esprit et même les personnages du livre. On peut toutefois, si compréhensible que soit la position de l’auteur, trouver bien des qualités au travail de Kaufman et de Carrière.

Tomas (Daniel Day-Lewis) et Sabina (Lena Olin) : I really like you, Tomas. You are the complete opposite of kitsch. In the kingdom of kitsch you would be a monster.
Quelques mots sur le roman (et sur Kundera)
Revenons rapidement sur le roman, avant d’aborder à nouveau son adaptation cinématographique. L’Insoutenable légèreté de l’être se déroule à Prague à la fin des années 60, à l’époque de l’invasion de la Tchécoslovaquie par l’Union Soviétique. Le récit se concentre plus particulièrement sur quatre personnages : Tomas, un chirurgien séducteur et libertin ; sa compagne Tereza, qui souffre des infidélités de son mari ; Sabina, maîtresse de Tomas, et qui partage son goût de la liberté et de l’indépendance ; et enfin Franz, un professeur genevois épris de Sabina.
Comme son (très beau) titre le suggère, le point de départ de L’Insoutenable légèreté de l’être est une réflexion autour d’une contradiction, la plus mystérieuse et la plus ambiguë de toutes
: celle entre la légèreté et la pesanteur. Pour approcher cette contradiction, l’auteur fait plusieurs fois référence au concept Nietzschéen de l’Éternel retour. Grossièrement, ce concept implique que toute chose se répète à l’infini, ce qui, selon le philosophe allemand, représente le plus lourd fardeau
pour l’être humain. Sans contredire formellement cette idée, Kundera lui oppose une vision selon laquelle la vie est une esquisse, et même une esquisse de rien, puisqu’elle ne précède aucune forme plus aboutie (L’histoire est tout aussi légère que la vie de l’individu, insoutenablement légère, légère comme un duvet, comme une poussière qui s’envole, comme une chose qui va disparaître demain
).
Les personnages apportent chacun un éclairage distinct autour de cette question centrale. Tomas évoque plutôt l’idée de légèreté, dans son rapport aux femmes et à l’existence en général (il y avait en lui un désir profond de changer le lourd en léger
) ; à l’inverse, Tereza semble porter constamment sur ses épaules un fardeau, en grande partie légué par une mère indélicate.

Pour les scènes montrant l’invasion de Prague par les russes, Philip Kaufman a utilisé des images d’archives, qu’il a combinées avec des séquences tournées à Lyon.
Lors d’un passage significatif, Kundera prend un exemple très simple pour illustrer l’opposition légèreté/pesanteur. Beethoven composa un jour un thème pour quatre voix sur les paroles Es muss sein
(il le faut
). Initialement, cette phrase faisait référence à un échange cocasse avec un homme qui devait cinquante forints au célèbre compositeur ; mais une année plus tard, ce même motif prit dans le quatuor opus 35 une dimension plus grave et dramatique. C’est donc un passage du léger au lourd, un processus que tout le monde accepte communément, nous explique Kundera, tandis que le cheminement inverse (du lourd au léger) provoque fréquemment l’indignation.
Cette réflexion est représentative de l’œuvre de Kundera et, pourrait-on dire, de sa philosophie : l’écrivain prône en effet souvent la plaisanterie (c’est d’ailleurs le titre de l’un de ses romans) et l’ironie (omniprésente dans ses livres) en opposition à l’esprit de sérieux
. Son dernier roman en date, La Fête de l’insignifiance, est un bon exemple de cette approche, tandis que dans La Lenteur (1995), la femme du narrateur avertit ainsi ce dernier : Je te préviens. Le sérieux te protégeait. Le manque de sérieux te laissera nu devant les loups. Et tu sais qu’ils t’attendent, les loups.
Dans la même optique, il se défend d’être un auteur à message. Dans L’Insoutenable légèreté de l’être, comme dans la plupart de ses romans, il analyse avec une finesse remarquable (et sans verbiage : Kundera a le don d’exprimer une idée subtile à travers une phrase limpide) les comportements et sentiments des protagonistes, sans jamais porter de jugement moral et sans chercher à asséner un propos bien défini dans l’esprit du lecteur. Il a d’ailleurs écrit quelque chose de très beau dans son essai L’Art du roman (1986), dont beaucoup d’artistes gagneraient à s’inspirer : Dans le territoire du roman, on n’affirme pas : c’est le territoire du jeu et des hypothèses
(lire La Fête de l’insignifiance, sur Télérama.fr).
Une adaptation incomplète, mais traversée par de beaux moments
A bien des égards, le film de Philip Kaufman ne trahit pas les intentions de l’auteur, pas plus que sa philosophie. En revanche, le scénario se concentre sur les événements et les étapes de la vie des personnages sans apporter l’analyse que l’écrivain en fait. Le résultat est à la fois juste et incomplet. Juste parce que les personnages du film semblent être des projections relativement conformes à ceux écrits par Kundera (en dépit des réserves de ce dernier). On associe en effet volontiers aux Tomas, Tereza, Franz et Sabina du roman le physique, les gestes, intonations et postures que Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche, Derek de Lint et Lena Olin leur prêtent dans le film – et cette correspondance est déjà une belle réussite. Mais résultat incomplet donc, car comme le traitement de ces mêmes personnages est moins approfondi que dans le livre, certaines de leurs attitudes s’avèrent peu compréhensibles.
On est par exemple interloqué par les cris singuliers poussés par Juliette Binoche pendant les relations sexuelles, tandis que les raisons de ses cauchemars récurrents demeurent assez floues, quand tout cela est parfaitement expliqué dans le roman. La séquence à Genève est bancale : la relation Franz/Sabina ne fait pas totalement la lumière sur la personnalité de cette dernière (on constate sa fuite en avant, sans identifier précisément les mécanismes qui en sont à l’origine), tandis que le retour précipité de Tereza à Prague n’est pas introduit : on a presque le sentiment qu’il manque une ou deux scènes.
En fait, on peut dire que Jean-Claude Carrière, Philip Kaufman et les comédiens ont compris les personnages du roman (à en juger par l’interprétation qu’ils en donnent), mais qu’ils ne font pas le nécessaire pour qu’un spectateur n’ayant pas lu ce dernier les comprenne véritablement à son tour. Quant aux réflexions de Kundera sur le hasard, la légèreté, etc., elles sont évoquées de-ci de-là sans trouver dans le film un écho saisissant.
Mais malgré ces limites, L’Insoutenable légèreté de l’être dégage un réel pouvoir de séduction – le film charme, séduit, un peu à l’image du personnage joué par Daniel Day-Lewis. D’abord, il parvient à poser un contexte, une époque, un cadre (bien qu’il ait été tourné en France, et non en Tchécoslovaquie). Ensuite et surtout, il en émane une grâce, plus ou moins perceptible selon les scènes, mais qui ne s’éteint jamais et qui atteint son paroxysme dans les très beaux derniers instants du film.
Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. Au niveau purement esthétique, le film bénéficie de la réalisation élégante de Philip Kaufman (qui à l’époque venait de signer L’Étoffe des héros, brillante adaptation d’un roman de Tom Wolfe) et de la photographie du talentueux Sven Nykvist, chef opérateur suédois et fidèle collaborateur d’Ingmar Bergman, dont le travail raffiné sur la lumière donne lieu à de délicates scènes d’intimité. Ensuite, la présence et l’aura des comédiens sont un atout considérable. Cela vaut pour l’ensemble du casting (dont la suédoise Lena Olin et son fameux chapeau), mais plus particulièrement pour Juliette Binoche et Daniel Day-Lewis : leur cinégénie est telle que certaines images, finement éclairées par Nykvist, expriment une sensualité poétique faisant écho au joli poème que Kundera a écrit spécialement pour le film (voir ci-dessous).

Tomas (Daniel Day-Lewis) murmure à l’oreille de Tereza (Juliette Binoche) un poème écrit par Kundera pour le film : You can sleep. Sleep in my arms. Like a baby bird. Like a broom among brooms… in a broom closet. Like a tiny parrot. Like a whistle. Like a little song. A song sung by a forest… within a forest… a thousand years ago.
La musique omniprésente du compositeur tchèque Leoš Janáček souligne l’élégance, la délicatesse que Philip Kaufman et Jean-Claude Carrière sont parvenus à capter, fut-ce de manière épisodique. S’il manque donc bel et bien des éléments à mon sens indispensables à la compréhension du récit et des personnages, le réalisateur et son co-scénariste ont néanmoins réussi à saisir cette atmosphère Bohême
dans laquelle baignent ces derniers ; atmosphère qui, sans compenser totalement les points faibles de l’ensemble, procure un indéniable plaisir de vision.
L'Insoutenable légèreté de l'être nous met face à un curieux paradoxe. D'un côté, les auteurs du film et les comédiens sont suffisamment justes pour qu'on en déduise qu'ils ont compris et respecté le roman de Kundera ; et de l'autre, le scénario fait l'impasse sur des éléments fondamentaux, de sorte que le spectateur reste souvent sur le pas de la porte et ne peut pas totalement partager cette compréhension. Il pourra, en revanche, apprécier les qualités esthétiques du film, son atmosphère gracieuse, sa jolie musique, le talent (et la beauté) des comédiens et un final émouvant.


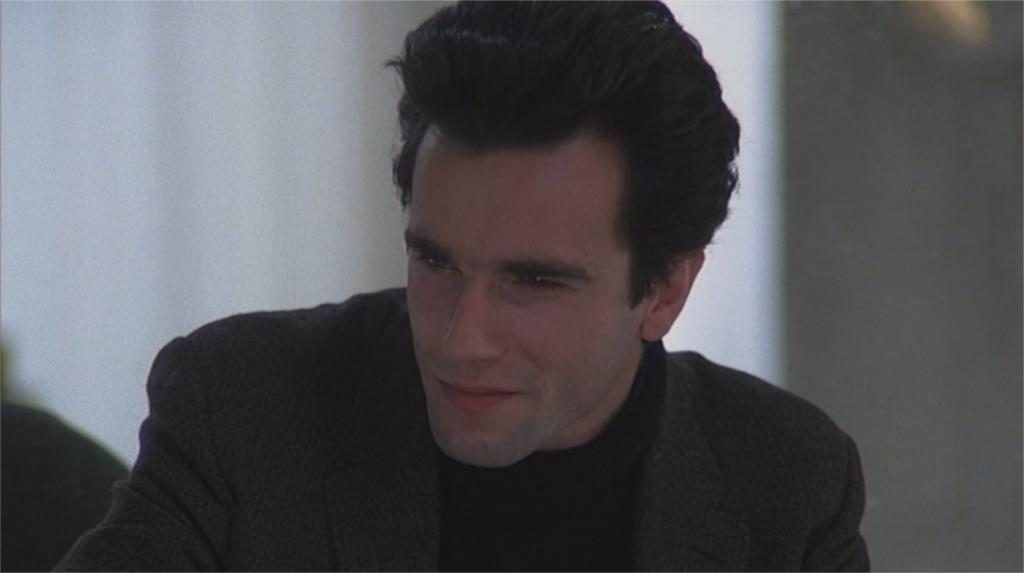

























Aucun commentaire