Film de Bruce McDonald
Année de sortie : 2008
Pays : Canada
Scénario : Tony Burgess, d’après son roman Pontypool changes everything
Photographie : Miroslaw Baszak
Montage : Jeremiah Munce
Musique : Claude Foisy
Avec : Stephen McHattie, Lisa Houle, Georgina Reilly, Hrant Alianak
Grant Mazzy: You know the french philosopher Roland Barthes once described trauma as a news photo without caption. And that, folks, is what I think we have here now.
Pontypool changes everything, comme dit le livre dont le film de Bruce McDonald est tiré. C’est vrai à bien des égards.
Synopsis de Pontypool
Grant Mazzy (Stephen McHattie), un animateur radio, arrive un matin dans la station de radio locale de la petite ville de Pontypool, dans l’Ontario, où l’attendent la productrice Sydney Briar (Lisa Houle) et la technicienne Laurel-Ann Drummond (Georgina Reilly), récemment rentrée d’Afghanistan.
Peu de temps après le début de l’émission, le reporter Ken Loney, qui travaille à l’extérieur de la station, leur décrit une émeute violente, se produisant aux alentours de la propriété du docteur John Mendez (Hrant Alianak). Une partie de la population de Pontypool semble gagnée par une fureur étrange et inexplicable. Autre détail inquiétant : certains habitants se distinguent par leur manie de répéter en boucle un mot particulier, qui change selon les cas de figure…
Critique du film
Pontypool : l’imagination et la suggestion comme ressorts de l’horreur
Pontypool se passe entièrement dans une station de radio. Le spectateur ne voit jamais ce qui se produit dans la ville qui donne son titre au métrage : il l’entend, comme les trois protagonistes. Ce parti pris permet de partager le point de vue de ces derniers ainsi que leur incompréhension, d’abord totale, des événements se déroulant autour d’eux (or ce qu’on ne comprend pas est toujours plus effrayant). Il stimule aussi particulièrement notre imagination : au spectateur d’imaginer, à sa manière, les scènes suggérées ou décrites par les témoignages et les bruits qui parviennent jusqu’à la station. Or, comme bien des réalisateurs l’ont démontré (de Jacques Tourneur à Steven Spielberg, de Roman Polanski à Ridley Scott, de Robert Wise à Jack Clayton, pour ne citer qu’eux), c’est en n’en montrant pas trop à l’écran qu’on effraie et qu’on fascine le plus les spectateurs.
Le procédé exigeait ici un travail particulièrement pointu sur la bande sonore, laquelle est remarquable : les voix radiophoniques, les différents bruitages et la musique (comme, par exemple, cette déflagration musicale qui accompagne l’entrée de Grant dans le local où il travaille, donnant à un événement a priori anodin une connotation étrange, prémonitoire) contribuent à l’aspect envoutant et mystérieux du film. Pontypool évoque un peu une interférence, un grésillement énigmatique au sein duquel on percevrait peu à peu un sens, comme lorsque l’on tourne le bouton d’une radio pour mieux capter ce qu’elle émet — geste régulièrement effectué par les personnages du film.
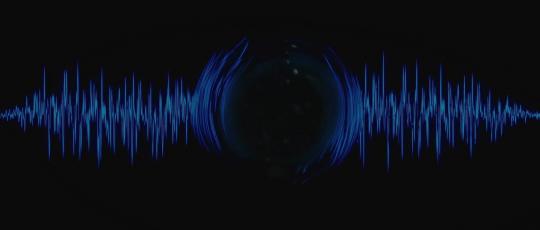
La bande son n’est bien sûr pas l’unique élément qui explique la réussite de Pontypool. La caractérisation des personnages ; leur background respectif (qui résonne, chacun à sa manière, avec le sens de l’histoire) ; le talent de leurs interprètes ; la réalisation maîtrisée de Bruce McDonald et enfin la photographie de Miroslaw Baszak (qui travailla avec George A. Romero sur son film Land of the Dead) sont autant d’aspects artistiques et techniques qui contribuent à la grande efficacité de l’ensemble. D’autant plus qu’ils sont mis au service d’un récit diablement intelligent.

Le propos du film, qui n’est jamais explicité (et c’est toute l’intelligence d’une œuvre que de laisser aux spectateurs le soin de la décrypter), est déroutant : Pontypool n’emprunte décidément pas les mêmes chemins que la plupart des films de genre auxquels on pourrait le comparer à la simple lecture du pitch (on le considère souvent comme un film de zombies, ce qui en donne une idée tout à fait trompeuse). Ses voies sont plus sinueuses, et leur débouché plus surprenant.
Car c’est une œuvre subversive, rebelle, profondément politique (presque philosophique en un sens) qu’on nous propose ici. Le fait qu’un film d’horreur soit politique est loin d’être nouveau en soi (les films de Romero, pour la plupart, le sont, par exemple) ; en revanche l’idée principale de Pontypool est tout à fait originale, inédite même : elle ne me semble pas avoir son pareil dans l’histoire du cinéma horrifique.
Une œuvre contestataire
[CONTIENT DES SPOILERS] Si Pontypool appartient à un sous-genre, le pandemic movie, il n’en reprend pas les principaux codes. Déjà, nous n’avons pas affaire ici à un virus chimique ou biologique : dans Pontypool, le virus se niche dans le langage, donc dans la conscience (le développement et l’apprentissage du langage étant intimement liés à la construction de la conscience humaine). À travers cette épidémie qui se répand donc par les mots et par leur compréhension (il fallait quand même y penser !), c’est le diagnostic d’une humanité conditionnée, acculée dans les impasses de son histoire qui semble être fait par Bruce McDonald et Tony Burgess, respectivement réalisateur et scénariste du film.
L’agressivité des personnes contaminées est en effet le reflet d’une conscience humaine malade, traumatisée et par-dessus tout aliénée. Une conscience enfermée dans des concepts, et plus concrètement des politiques (car le film a, encore une fois, une portée politique) qui écrasent la créativité et la liberté individuelles.

Ce n’est pas un hasard si Grant Mazzy fait à un moment référence à son enfance, ni si on entend une voix d’enfant dans les râles d’agonie d’un adulte lors d’une séquence tout à fait glaçante : dans Pontypool, le salut passe par un regard nouveau sur le monde, donc en un sens un regard enfantin, libéré du poids de l’histoire et de l’ordre établi.
Ordre qui dans le film est évoqué de plusieurs manières : par le biais du pouvoir militaire et politique (You’re just killing scared people, that’s what you always do
), mais aussi à travers l’expérience de Grant, renvoyé d’une radio nationale car on lui refusait une certaine liberté d’expression. « Liberté » est d’ailleurs l’un des mots-clés de ce film qui semble dénoncer un monde où elle a de moins en moins sa place (on notera aussi le passé militaire de Laurel-Ann, qui de toute évidence l’a marquée).
(Notons que la station de radio est bâtie sur les fondations d’une église, ce qui n’est pas fortuit ; la dernière scène avant le générique a d’ailleurs une connotation très nettement religieuse.)
La force du film est de faire passer un discours qui est donc subversif, critique, sans tomber dans le sentencieux, la didactique, et encore moins dans le pathos. À l’inverse de nombreux longs métrages dont le message est asséné sur la tête du spectateur, Pontypool communique d’une manière subtile, codée. L’œuvre de Bruce McDonald ressemble à un signal entêtant qui viendrait pirater la fréquence souvent prévisible du cinéma d’horreur, pour y diffuser des ondes dissonantes et étranges. Ondes qui résonnent encore après la vision d’un film qui ne ressemble à aucun autre, comme son titre à la sonorité singulière, et comme l’endroit qui n’existe pas encore
(a new place, that isn’t even there yet
) évoqué dans la brillante séquence qui ponctue le générique de fin.

Vidéo : le générique de Pontypool
Il s’agit ici du générique de début du film. C’est Grant Mazzy (Stephen McHattie), l’un des protagonistes, qui parle. La séquence est très efficace, pour plusieurs raisons.
D’abord, elle permet d’éveiller d’emblée la curiosité du spectateur (something’s going to happen
) et familiarise celui-ci avec ce qui est l’une des particularités du film : faire ressentir les choses davantage par les mots et les sons que par les images. On remarquera d’ailleurs la voix pénétrante du personnage (avec un son typique de la radio) ainsi que l’ambiance sonore inquiétante.
Ensuite, à travers ce texte, Grant Mazzy s’interroge sur le sens caché des choses. Or Pontypool est un film qui n’explique pas tout : le spectateur est amené à réfléchir pour tenter de comprendre la signification de l’histoire. Il y a également un jeu autour du sens des mots et du langage (Pontypool, Panty Pool, Pont de Flaque
), que l’on retrouvera plus tard dans le film et qui prendra même une importance majeure.
Enfin, on notera la référence à l’écrivain et réalisateur américain Norman Mailer, référence très cohérente : Mailer, l’un des fondateurs du journal The Village Voice, était un artiste engagé, souvent critique à l’égard de la politique de son pays. Or Pontypool est, comme nous l’avons déjà constaté, profondément contestataire (soulignons que le scénario fait aussi référence au philosophe français Roland Barthes, à travers une citation — indiquée en exergue — qui convient parfaitement au film).
Transcription de la vidéo (en français)
Grant Mazzy : Le chat de Mme French a disparu. Des affiches sont disposées dans toute la ville. « Avez-vous vu Honey ? » Nous avons tous vu les affiches, mais personne n’a vu Honey le chat. Personne. Jusqu’à jeudi matin dernier, lorsque Mademoiselle Colette Piscine fit une embardée pour éviter Honey le chat tandis qu’elle traversait le pont. Ce pont, maintenant légèrement endommagé, est un peu un trésor local et a même son propre nom fantaisiste : Pont de Flaque. Colette, cela sonne comme « culotte ». Le mot français pour « panty ». Et « piscine » signifie « pool ». Panty pool. « Flaque » est également le mot français pour « pool », donc Colette Piscine, le français de Panty Pool, conduit sur le pont de Flaque, le Pont de Pool si vous voulez, pour éviter de percuter le chat de Mme French qui a disparu à Pontypool. Pontypool. Pontypool. Panty pool. Pont de Flaque. Qu’est-ce que cela signifie ? Et bien, Norman Mailer avait une théorie intéressante pour expliquer les étranges coïncidences entourant l’assassinat de JFK. Dans le sillage des événements de grande ampleur, avant et après leur survenue, des détails bouillonnent, se libèrent pendant un moment ; et quand ils sont considérés à nouveau ils coïncident soudainement, d’une étrange façon. Noms de rue et dates de naissances et prénoms, toutes sortes de choses superflues semblent être reliées les unes aux autres. C’est l’effet « onde de choc ». Alors, qu’est-ce que cela signifie ? Et bien… cela veut dire que quelque chose est sur le point d’arriver. Quelque chose d’énorme. Mais après tout, il y a toujours quelque chose qui est sur le point d’arriver…
Liens utiles
- Interview de Bruce McDonald au sujet de Pontypool
- Article sur le roman Pontypool changes everything de Tony Burgess, sur le site HorrorScope (en anglais)
De par son originalité et son brillant sous-texte politique, le trop méconnu Pontypool s'affirme comme l'un des meilleurs films d'horreur contemporains. Parlez-en autour de vous, mais faites attention à ne pas répéter son titre trop souvent...

























6 commentaires
J’ai bien aimé ce film que j’ai trouvé audacieux et abouti, aussi bien du point de vue de la réalisation que du scénario (pour le coup, j’aimerais bien lire les romans). Dommage qu’il n’ait pas plus fait parler de lui (à part auprès des aficionados du genre)…
Tout à fait d’accord… Il y a tellement de films qui font plus de bruit pour moins que ça ! Le livre me tente aussi, par contre il n’est disponible qu’en anglais a priori.
Putain! vraiment déroutant!
Surtout, allez jusqu’au bout du générique de fin. En effet, ça change du film d’horreur traditionel. J’aime beaucoup l’idée du langage a réinventé. Et aussi sur le sens des mots ,des mots, des mots , des mots , des mots , des mots, des mots ,des mots, des mots , des mots , des mots…..
Un film intéressant oui, et ta critique lui rend un bel hommage.
Merci !
Mieux vaut réécouter l’adaptation de « La Guerre des mondes » par le Mercury Theatre, exemple indépassable de « radio-réalité ».